Congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré : la révolution de la Cour de cassation !
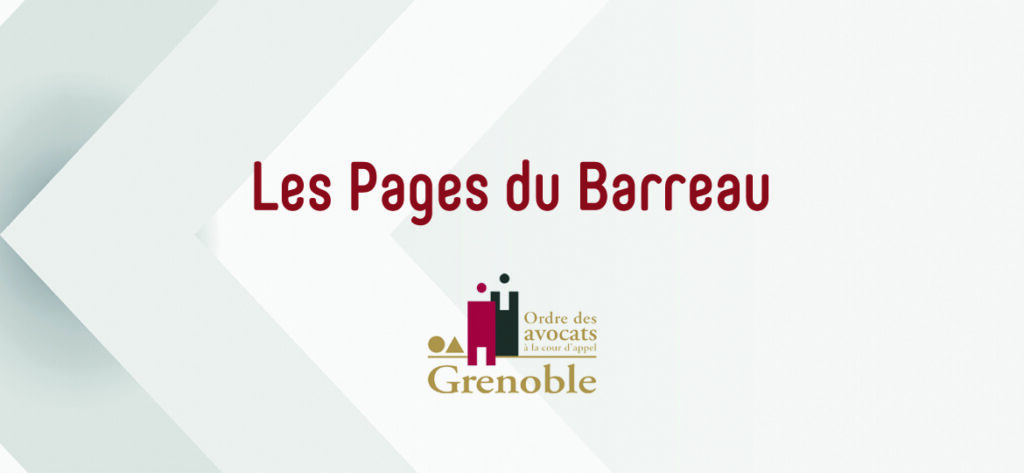
Site de publication d’annonces légales juridiques

Tél. : 04 76 84 32 01
juridique@legalcie.fr
Tél. : 04 76 84 32 01
juridique@legalcie.fr
Tél. : 04 76 84 32 01
juridique@legalcie.fr
Tél. : 04 76 84 32 01
juridique@legalcie.fr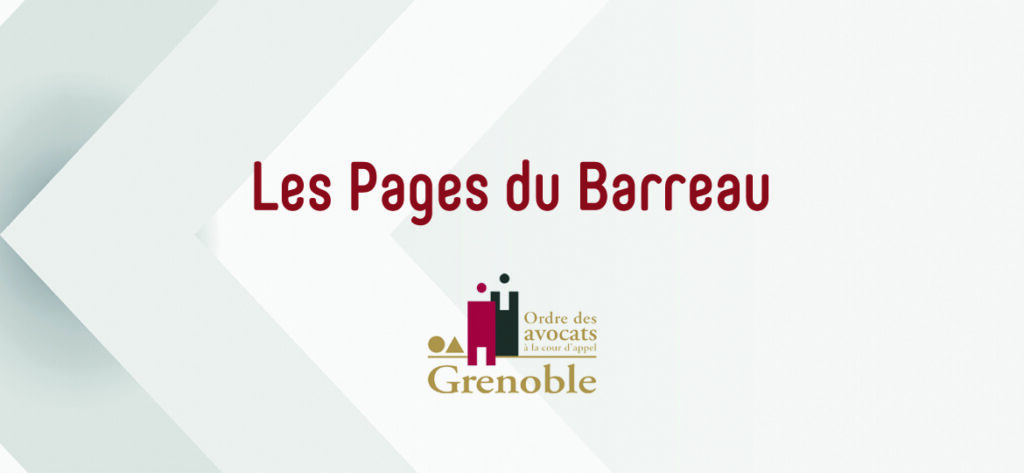
Congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré : la révolution de la Cour de cassation !
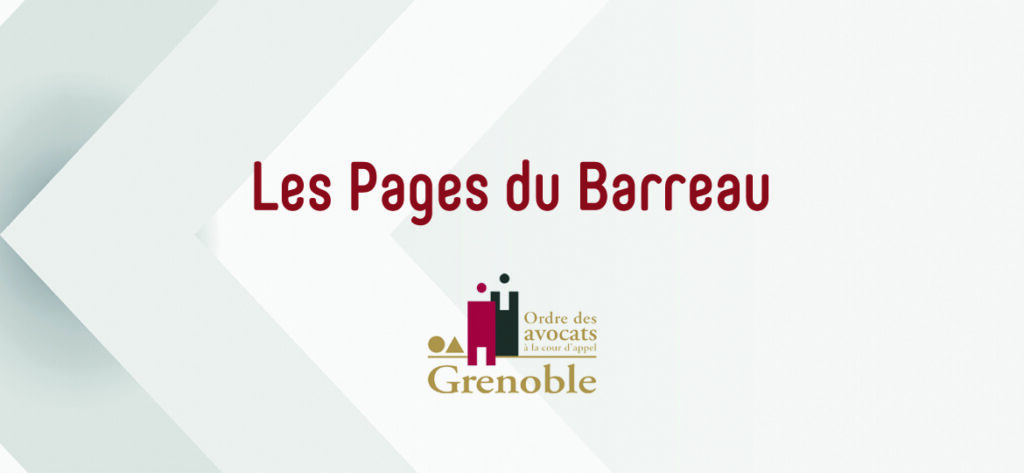
La signature électronique des contrats s’est considérablement développée ces dernières années, notamment depuis la crise du Covid. Pourtant, toutes les entreprises n’ont pas encore adopté ce système, dont le régime juridique reste assez complexe. En parallèle, le recours à la signature numérisée est de plus en plus fréquent, mais sa validité juridique reste incertaine. L’occasion de faire le point sur ces différentes techniques.
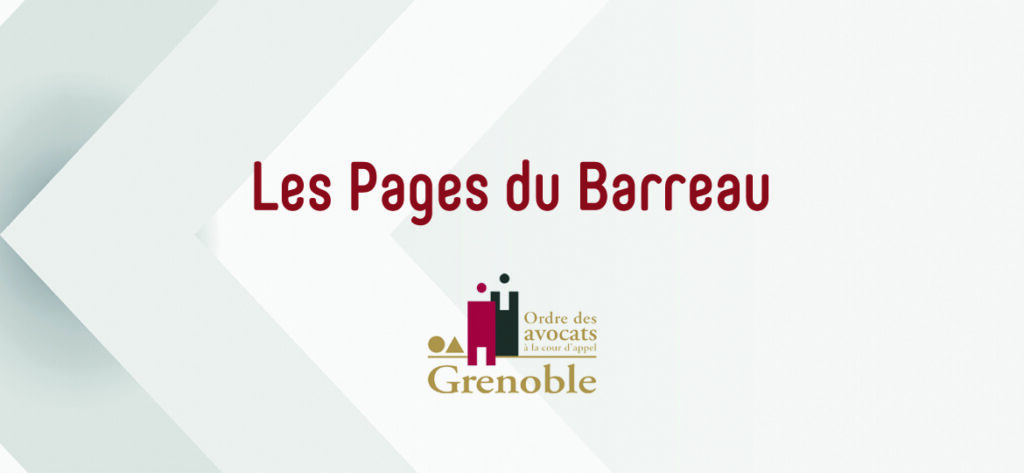
Voilà six ans qu’était attendue de la Haute Juridiction administrative une clarification sur l’existence ou non d’une obligation de sélection préalable à l’occupation du domaine privé des collectivités publiques à vocation économique. Toute incertitude sur l’état du droit est désormais levée. Retour sur un imbroglio juridique.
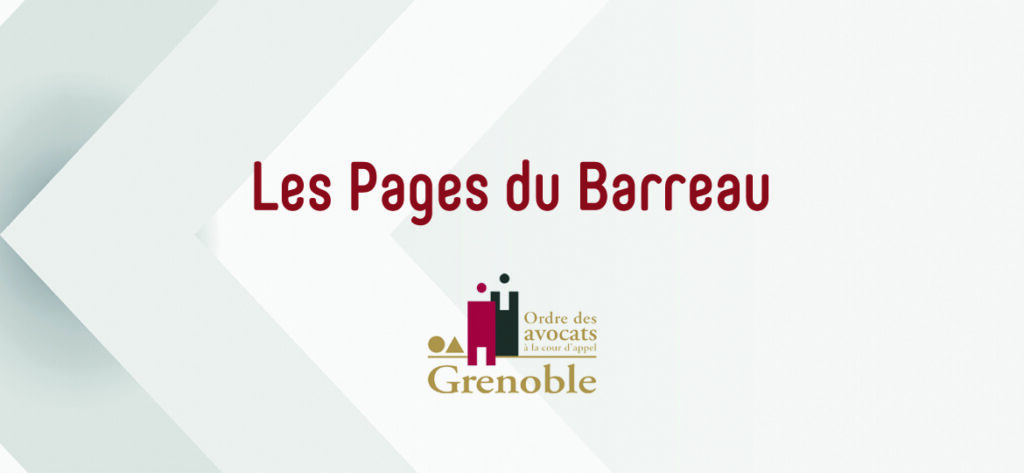
L’Union européenne a publié en octobre 2022 le Digital Services Act package, composé de deux règlements, dont l’objectif est de réguler les marchés et les services sur internet.
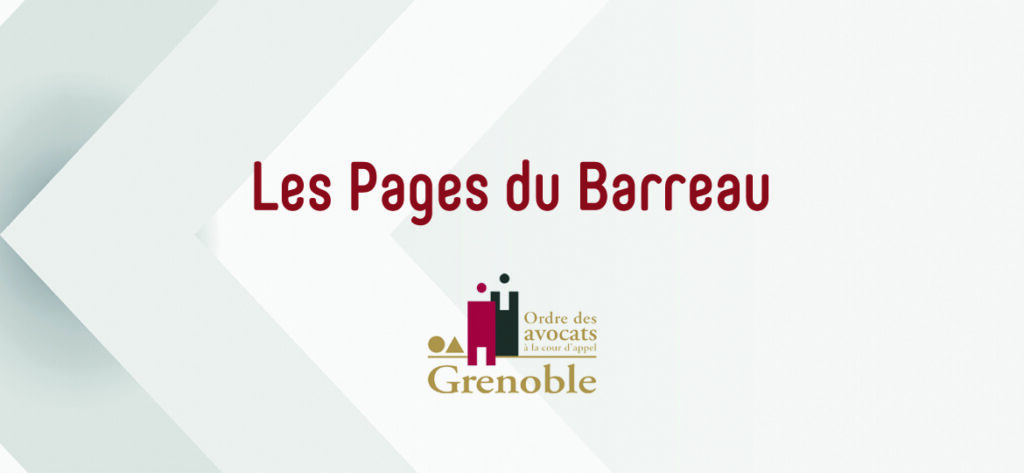
L’outil le plus évident est le document de planification. Le plan local d’urbanisme (intercommunal) ou PLU (i) met à disposition une série d’outils qui peuvent être mobilisés pour s’assurer de la mise en œuvre d’un projet adapté et qualitatif. Son règlement, écrit et graphique, ainsi que ses orientations d’aménagement et de programmation (OAP) servent de cadre au projet urbain souhaité par les élus.
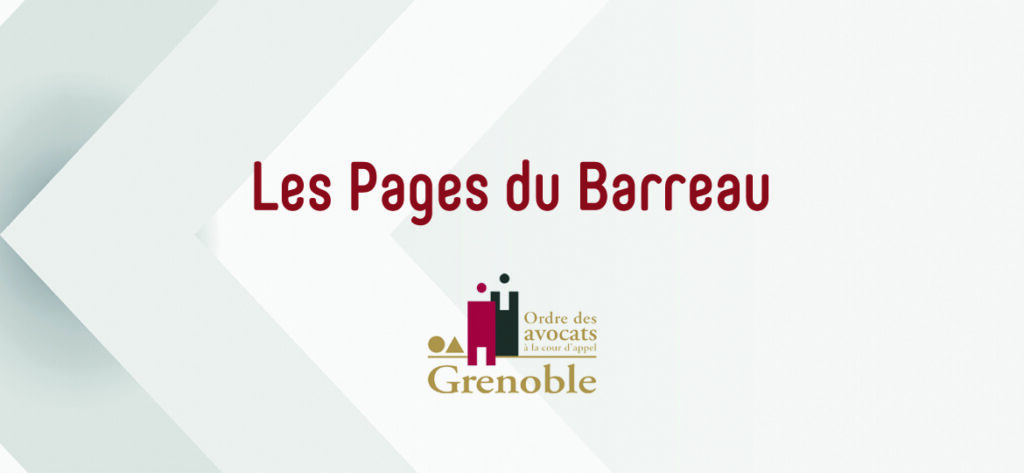
La pratique de la chasse a de tout temps reposé sur une dialectique : concilier l’existence de populations de gibier les plus importantes possibles avec les capacités d’accueil des territoires.


L’examen de conformité fiscale existe depuis les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, mais n’est pas encore assez développé. Il est réalisé en toute indépendance et en dehors de tout conflit d’intérêts. Il se fait à la demande d’une entreprise, pas forcément cliente qui souhaite un contrôle préventif sous la forme d’un audit. Ce dernier se matérialise par un compte rendu de conformité aux règles fiscales, selon un cahier des charges défini par décret.
Toutes les entreprises sont concernées, peu importe leur forme, leur régime d’imposition ou leur chiffre d’affaires. Le seul critère est que l’ECF se fait sur une activité professionnelle.
Les SCI patrimoniales, les activités de location meublée non professionnelle (LMNP) sont donc exclues.
1- Une case ECF est cochée lors du dépôt de la liasse fiscale
2- Un compte rendu de mission est rempli par le professionnel du chiffre. Il est envoyé au client et télétransmis à l’administration, dans un délai de six mois après le dépôt de la liasse fiscale pour un exercice ne coïncidant pas avec l’année civile ou avant le 31 octobre N + 1 pour les exercices clôturant le 31 décembre N.
1-2 – Conformité et qualité du FEC (fichier des écritures comptables)
3 – Détention d’un certificat de l’éditeur de caisse
4 – Respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents
5 – Validation du respect des règles liées au régime d’imposition en matière d’IS et de TVA
6-7-8 – Règles de détermination des amortissements, provisions, charges à payer et leur traitement fiscal
9 – Qualification et déductibilité des charges exceptionnelles
10 – Règles d’exigibilité de la TVA.
Il est normé par le décret, et est organisé en plusieurs parties :
1- L’identification du prestataire : son SIREN et sa dénomination
2- Renseignements relatifs au client : identification, nom prénom, raison sociale, adresse, SIRET, mode d’exercice (individuel ou sociétal), nombre d’associés, date de réception de la déclaration de résultats, période d’imposition, résultat déclaré, date d’établissement du compte rendu, montant du chiffre d’affaires HT réalisé sur l’exercice
3- Conclusion du compte rendu : cinq conclusions sont possibles avec des degrés de « gravité » différents : absence d’anomalie ; absence d’anomalie après régularisation ; transmission d’une déclaration rectificative à notre demande : régularisation du résultat imposable, TVA collectée ou déductible et montant en jeu. Présence d’anomalies …


Comment en finir avec ces procès qui durent des années, pour une issue incertaine, publique, imposée et souvent insatisfaisante ? Notre Justice malade, comme bien d’autres de nos services publics, souffre d’un manque de moyens. La médiation peut permettre de renouer le dialogue là où on le croyait devenu impossible. Les avocats le savent et la proposent de plus en plus souvent à leurs clients afin de leur éviter des années de gâchis, avant tout procès ou en cours de procédure, y compris si leur client y semble a priori hostile.
La médiation permet à des parties, alors appelées ” médiés “, d’éviter ou de mettre fin au procès en trouvant un accord amiable grâce à un médiateur professionnel spécialement formé à des méthodes et techniques d’écoute, de communication, et d’autres outils lui permettant de diriger les échanges jusqu’à faire renouer le dialogue à des personnes en situation de conflit qui paraît inextricable, au moins juste assez pour trouver une solution à leur problème dans trois cas sur quatre, parfois même se réconcilier. La parole est libérée, même dans le milieu des affaires, les médiés peuvent se dire ce qu’ils ont sur le cœur, ce qui n’est pas possible lors d’un procès.
La médiation n’est pas la conciliation (en général imposée, formelle et expéditive), ni l’arbitrage (où un tiers est rémunéré par les parties pour leur imposer une décision comme une sorte de juge privé).
Il y a deux types de médiation : la médiation judiciaire, qui est ordonnée par un juge (articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile) et la médiation conventionnelle (c’est-à-dire contractuelle, prévue ad hoc ou en amont par une clause du contrat : articles 1530 à 1535 du même code). Mais le processus reste le même. La médiation est maintenant obligatoire pour tous les litiges dont l’enjeu est inférieur ou égal à 5 000 euros (article 750-1 du même code) et dans certains autres cas.
Le Code national de déontologie du médiateur la définit comme ” un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits “. Ainsi, la médiation est un processus rapide, économique et confidentiel. La médiation peut transformer un conflit en une opportunité (lire les trois articles spécial médiation parus dans Les Affichesdes 3, 10 et 17 décembre 2021).
Le médiateur est un professionnel formé au processus de la médiation (la formation universitaire dure plus de 200 heures), aux techniques de communication et de gestion des émotions. Il peut être issu de tout milieu professionnel. Ni juge, ni arbitre, ni expert, le médiateur n’a aucun pouvoir de décision. Il n’a que les compétences pour les amener à les rendre à nouveau capables de communiquer suffisamment pour trouver un accord par eux-mêmes. Il travaille souvent avec un co-médiateur.
Au départ, les médiés peuvent se détester, refuser de se parler, de se voir, ou même de proposer à l’autre une médiation. Ici le rôle des avocats est primordial pour convaincre leur client de l’intérêt pour eux de tenter la médiation. Le médiateur peut aussi prendre contact avec chaque médié, y compris pour proposer la médiation et expliquer son fonctionnement, mais aussi pour amener à réfléchir sur ses motivations, ses enjeux et objectifs, ses risques. Indépendant et impartial, affilié à un centre de médiation ou non, choisi par les médiés ou désigné par le juge ou par un centre de médiation, le médiateur pratique l’écoute active et s’efforce de rester neutre dans les échanges, qu’il orchestre en veillant à reformuler ce qui est dit par chaque médié en laissant la place à chacun d’exprimer tout ce qui a besoin de l’être.
De cette manière, peu à peu chaque médié va commencer à apercevoir le point de vue de l’autre, peut-être à le comprendre, à moins le considérer comme un ” ennemi “, et le dialogue redeviendra possible.
Où trouver un médiateur compétent ? Adressez-vous au Centre des avocats médiateurs de l’Isère (Cami) qui propose des avocats formés pendant deux ans pour devenir aussi médiateurs, ou encore à Arcada, centre de médiation qui propose des médiateurs expérimentés et de proximité, ou enfin à Calma Médiation, qui propose des médiations sans frontières, notamment pour les entreprises et les dirigeants.
Avant procès, il est toujours préférable de tenter d’abord un accord à l’amiable via une négociation en direct ou par le biais de ses avocats. D’ailleurs, les articles 56 et 58 du Code de procédure civile imposent que l’assignation, la requête ou la déclaration de saisine du juge indique les diligences qui ont été entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige (sauf motif légitime). Cela inclut notamment les modes amiables de règlement des différends (Mard), tels qu’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. À défaut, le juge peut proposer une conciliation ou une médiation (article 127 du même code).
La médiation devient pertinente lorsque les négociations n’aboutissent pas, que le désaccord a dégénéré en conflit, que la situation reste bloquée, que l’une ou l’autre des parties (ou les deux) se sent braquée. La communication ne passe plus : ” Je ne veux plus jamais le/la voir ni lui parler “, ” de toute façon il/elle ne comprend rien “, ” c’est allé trop loin, on ne peut plus se supporter “. Parler de l’autre et de la situation de conflit devient douloureux. On préfère ne pas se confronter à …
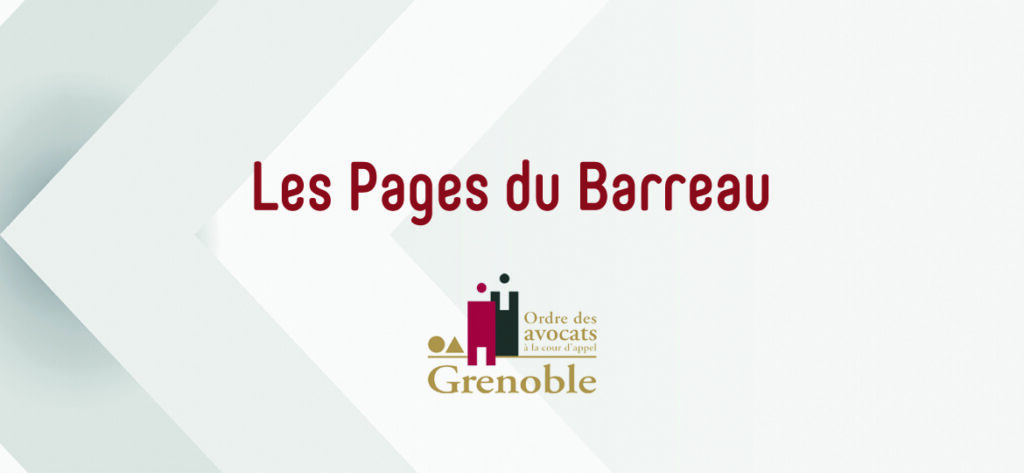
Pour les praticiens du droit et les services RH des entreprises, appréhender le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail est indispensable pour négocier et pour apprécier le risque prud’homal.

En 2020, la France passe d’une réglementation thermique à une réglementation environnementale, la RE2020, plus ambitieuse et exigeante pour la filière construction tant sur le plan technique que juridique. Depuis 1974, plusieurs réglementations thermiques ont été successivement mises en place.